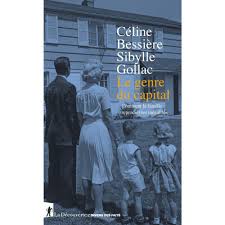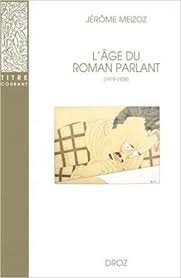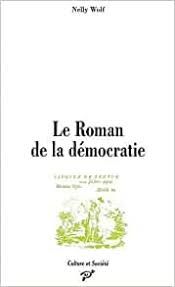Un fil sur les idées principales de cet article (en accès libre) de Bourdieu, recommandé par @MarCandea : «Vous avez dit "populaire" ?» Qu'est-ce que c'est un langage "populaire"? Et d'abord, que veut dire le mot "populaire" lui-même?  https://twitter.com/ParlercommeJ/status/1335152409337847810
https://twitter.com/ParlercommeJ/status/1335152409337847810
 https://twitter.com/ParlercommeJ/status/1335152409337847810
https://twitter.com/ParlercommeJ/status/1335152409337847810
Selon Bourdieu, le mot "populaire" est difficile à approcher scientifiquement, car c'est une "épithète magique". Le mot "populaire" serait d'abord et avant tout une catégorie mythique, peu objectivable.
"Populaire", selon Bourdieu, c'est un signifiant avant d'abord politique, au sens flou, qui joue le rôle d'une reconnaissance (qqfois électorale), chacun·e peut le manipuler, le fixer à sa guise, selon ses propres fantasmes, sa propre position.
La notion de "langage populaire" serait aussi une catégorie mythique, qui participerait à une vision dualiste du monde : langage populaire (bas)/langage soutenu (élevé), le grossier (les gros mots)/le fin (les mots fins),la nature (les mots crus, une langue verte)/la culture, etc
Pour Bourdieu, cette vision binaire ne correspond pas au continuum des parlers et aux chevauchements entre ces parlers. Et il a bien raison. A l'école on apprend généralement 3 catégories de niveaux de langue (familier/courant/soutenu)...
Or si les registres de langue existent bien, nos énoncés ne forment pas, la plupart du temps, un tout harmonieux qu'on peut ranger dans une seule case. Par exemple "Je vois pas pourquoi tu t'emportes : dans quel case le ranger?
Il y a des marques de l'oralité (omission du "ne") qu'on considère souvent comme "populaires", mais le lexique "t'emportes" est considéré comme soutenu. Cet énoncé n'est ni populaire ni soutenu, la vision dualiste ne marche pas pour l'analyser.
Comme le dit Bourdieu il y a des chevauchements, par ex le familier : "parler relâché des locuteurs dominants": on ne jugera pas pareil des marques de parler relâché si elles sont le fait d'un locuteur que l'on sait dominant, qui montre et nous montre qu'il maîtrise le langage
On ne prendra pas de la même manière un "on s'en fout" lâché par un locuteur qui parle peu, qui maugrée et un "on s'en fout" lâché par exemple par un avocat au milieu d'une plaidoirie pour jouer sur un effet de familiarité, de connivence.
De même Bourdieu parle du "parler tendu des locuteurs dominés" : quand des locuteurs qui ne maitrisent pas la norme essaient de la respecter, ce qui va entrer en linguistique dans ce qu'on appelle l'hypercorrection.
Exemple : "Mon mari, dont je suis sans nouvelles de lui, a disparu depuis tant de jours". Ce n'est ni du soutenu (la norme syntaxique n'est pas bien identifiée et respectée) ni du familier (on voit bien qu'il y a un effort, un "parler tendu").
Donc la plupart du temps les parlers et les catégories se chevauchent. La notion de "langage populaire" est une catégorie fourre-tout, à l'intérieur de laquelle on va trouver des langages très différents.
Certains parlers, par exemple, l'argot, le verlan vont rejouer ce principe de duplication. Selon Bourdieu l'argot est "une forme distinguée" du populaire, "le produit d'une recherche de la distinction, mais dominée, et condamnée, de ce fait, à produire des effets paradoxaux".
Si les énoncés ne sont pas réductibles à une catégorie, c'est aussi parce que les jugements sur les énoncés varient selon les marchés linguistiques. Un marché linguistique, c’est un espace social où les interactions langagières se voient attribuer une valeur particulière.
Bourdieu parle de marchés soumis aux normes dominantes (la médecine, la justice, l’école) auxquels il oppose des marchés francs, qui s’éloignent de ces normes dominantes, comme la discussion amicale au café. On en parle avec Maria Candea dans cet épisode ! https://www.binge.audio/podcast/parler-comme-jamais/paroles-ouvrieres-classe-a-part
Il y a des marchés affranchis des lois dominantes, qui vont développer d’autres normes, comme la prison. La même parole pourra être dévalorisée sur un marché linguistique, par ex le marché scolaire et valorisé dans un autre, par ex le marché linguistique amical, au café.
Ces marchés sont distincts, mais aussi hiérarchisés dans le monde social. Si vous maîtrisez la parole valorisée dans les marchés dominants, si la langue d'un marché comme l'école par exemple ressemble à celle que vous parlez à la maison, vous êtes sans doute parmi les dominants.
Se pose alors la question de se plier ou non aux codes des marchés dominants ou de garder, voire même d'exhiber un langage qui correspond aux codes des marchés dominés, d'en être fier même hors de ces marchés (ce qui peut correspondre à la stratégie du retournement du stigmate).
"Lorsque la recherche dominée de la distinction porte les dominés à affirmer ce qui les distingue,faut-il parler de résistance?Quand ils travaillent à perdre ce qui les marque comme vulgaires,et à s'approprier ce qui leur permettrait de s'assimiler, faut-il parler de soumission?"
Bourdieu parle aussi d'une sorte de division sexuelle du travail de conformité à la norme linguistique. En gros, que les femmes présenteraient davantage de docilité par rapport aux normes, parce qu'elles font le travail de représentation officielle du foyer
Cf travaux de Bessière et Gollac @genre_du sur les tâches administratives : les hommes pourraient se permettre d'avoir davantage une attitude subversive par rapport aux codes dominants du langage administratif (mutisme par ex) parce que les femmes se chargeraient de ce travail
Bref, finalement, que veut dire "langage populaire"? Malgré l'hétérogénéité de la notion, on peut, grâce à cet article de Bourdieu, dire que cela recoupe trois types de parler bien différents: https://www.persee.fr/docAsPDF/arss_0335-5322_1983_num_46_1_2179.pdf
1) les formes les plus tendues des marchés dits dominés, ou francs, comme l'argot. Ce sont des parlers tendus (qui témoignent d'un effort, d'une recherche), mais pas selon les normes dominantes, selon d'autres normes.
2) les formes de langage de locuteurs dominés quand ils doivent se conformer aux normes dominantes, qui naissent donc d'une insécurité linguistique (hypercorrection, mutisme, etc)
3) les formes de langage de la sphère privée, qui ne correspondent pas aux règles des marchés publics, quels qu'ils soient (justice ou bistrot).
Et pour aller plus loin, je vous conseille deux références stylistiques très intéressantes sur cette ambiguïté de la catégorie "populaire" dans le domaine littéraire:
Jérôme Meizoz, L’Âge du roman parlant (1919-1939).
Nelly Wolf, Le romand de la démocratie
Jérôme Meizoz, L’Âge du roman parlant (1919-1939).
Nelly Wolf, Le romand de la démocratie
Jérôme Meizoz, L’Âge du roman parlant (1919-1939), avec une préface de... Pierre Bourdieu.
L'exemple d'une démarche socio-stylistique: il s'agit de définir la poétique du "roman parlant", qui met l'oralité populaire au coeur pas slt du discours des persos mais de la narration...
L'exemple d'une démarche socio-stylistique: il s'agit de définir la poétique du "roman parlant", qui met l'oralité populaire au coeur pas slt du discours des persos mais de la narration...
... mais pour ce faire d'étudier les conditions de production et de réception de ce roman "oral", les critères de valeur de la langue littéraire auxquels le roman est soumis. Le populaire peut-il être, dans le roman, objet de la représentation mais aussi "sujet d'énonciation"?
Dans ses travaux sur démocratie et roman, N. Wolf considère que le roman peut expérimenter un nouveau contrat linguistique, de nouvelles normes pour juger une langue littéraire qui ne se marquerait plus par l'écart avec la langue quotidienne, "populaire"
Enfin sur l'évolution des rapports entre langue littéraire et langue commune(la langue littéraire s'identifie-t-elle à des normes hautes de la langue nationale? Cherche-t-elle au contraire à s'écarter de cette norme?) la référence majeure est cet ouvrage de G. Philippe et J. Piat
On discute de toutes ces notions dans le dernier épisode de @ParlercommeJ avec Maria Candea et Philippe Poutou c'est quoi une parole populaire? est-ce qu'il y a une parole populaire "authentique"? est-ce que cette notion d'authenticité n'est pas un piège? https://www.binge.audio/podcast/parler-comme-jamais/paroles-ouvrieres-classe-a-part
Maria puisque c'est toi qui recommandais l'article de Bourdieu, corrige-moi/ complète-moi si tu y voyais autre chose!!!

 Read on Twitter
Read on Twitter